 |
Qui
sommes-nous ? |
 |
Programme |
 |
Communiqués |
 |
Le
"Courrier" |
 |
Publications |
 |
Diffusez
vos idées |
 |
Adhérez |
 |
Liens
|
 |
Archives
|
 |
Qu'est-ce
que c'est ? |
 |
Un
cas SOS FM |
 |
Joindre
une antenne |
 |
Aider
SOS FM |
 |
Sa
vie avant la naissance |
 |
Qu'est-ce
qu'un avortement ? |
 |
Démographie
mondiale |
 |
F.A.Q. |
 |
Nous
contacter |
|
|
 Dans
le sens qui nous intéresse ici, l'avortement consiste en
la destruction du fœtus avant la naissance naturelle. Dans
le sens qui nous intéresse ici, l'avortement consiste en
la destruction du fœtus avant la naissance naturelle.
Aujourd'hui,
en France, comme chaque jour depuis 1975, des centaines d'enfants
non encore nés mais cependant bien vivants seront tués
par avortement légal.
On a calculé, sans exagérer, qu'en 25 ans,
plus de 6 millions de petits Français avaient été
sacrifiés à l'idéologie.
Qui
dira la somme de drames humains provoqués par ce massacre ?
Quant
au drame social, c'est la société française
toute entière qui commence à le vivre.
|
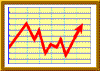 |
Pour
connaître les dernières statistiques officielles
des avortements pratiqués en France, cliquez sur le graphique,
ci-contre.
|
LES
PRINCIPALES MÉTHODES D'AVORTEMENT
|
 |
Aspiration
(dite méthode de Karman)
|
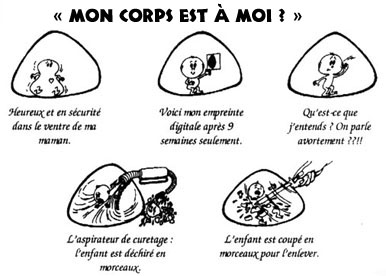 Pratiquée
sous anesthésie, cette méthode est la plus généralement
utilisée en France (50 % des cas). Pratiquée
sous anesthésie, cette méthode est la plus généralement
utilisée en France (50 % des cas).
Le col de l'utérus est dilaté est dilaté de
2 bons centimètres au moyen de dilateurs gradués dits
"bougies", allant de calibres très petits à
très gros jusqu'à permettre le passage d'un tube flexible
relié à une pompe sous vide qui dissèque l'enfant.
|
 |
Curetage
|
|
 Pour
les grossesses plus évoluées, par exemple à
12 semaines. Pour
les grossesses plus évoluées, par exemple à
12 semaines.
On dilate le col de l'utérus comme dans la méthode
précédente pour permettre l'introduction à
l'intérieur de l'utérus de la curette au moyen de
laquelle le fœtus est déchiqueté.
(Sur
la photographie, ci-contre, on peut constater que ce fœtus
âgé de 12 semaines manifeste de vives réactions
et tente de fuire la curette qui va le blesser et le déchiqueter
en morceaux).
|
 |
Injection
salée
|
 Cette
méthode abortive, sans doute la plus barbare de toutes, est
utilisée après 16 semaines lorsqu'il y a suffisamment
de liquide amniotique autour du bébé. On retire une
certaine quantité de ce liquide qui est remplacé par
une quantité équivalente de poison (une solution saline
très concentrée). Parfois, l'urée est aussi
utilisée. Cette
méthode abortive, sans doute la plus barbare de toutes, est
utilisée après 16 semaines lorsqu'il y a suffisamment
de liquide amniotique autour du bébé. On retire une
certaine quantité de ce liquide qui est remplacé par
une quantité équivalente de poison (une solution saline
très concentrée). Parfois, l'urée est aussi
utilisée.
Par cette méthode, on tue l'enfant en lui brûlant la
peau, les poumons en plusieurs heures de souffrances atroces. Si
elle n'est pas anesthésiée, la mère ressent
très fortement les mouvements de l'enfant agonisant dans
son ventre et accouche d'un enfant mort. |
 |
Administration
de prostaglandines
|
|
Les
prostaglandines sont des hormones naturelles ou synthétiques,
dont l'administration, qui se fait en comprimés, par intraveineuses
ou par voie vaginale, provoque des contractions de grande violence
et déclenche l'accouchement sous 48 heures.Un accouchement
prématuré déclenché de cette façon
dure au minimum 6 heures, délai qui est fatal au fœtus.
|
 |
Hystérotomie
(ou petite césarienne)
|
|
Tout
comme pour une césarienne, le ventre de la mère
est ouvert afin d'aller chercher le fœtus à l'intérieur
de l'utérus.
Bien que n'étant pas officiellement autorisé en
France, en dehors de "l'avortement thérapeuthique",
cette méthode est, en fait, de plus en plus pratiquée.
Extrait "intact", le fœtus peut ainsi devenir l'objet
d'expériences, voire de manipulations à fins commerciales
dont les limites sont sans cesse repoussées du fait d'un
vide juridique complet !
|
 |
Avortement
par naissance partielle
|
|
Cette
technique d'avortement consiste en l'extraction "intacte"
du corps du fœtus excepté sa tête, puis une
en aspiration de son cerveau.
Ce type d'avortement demande trois jours d'intervention dont deux
rien que pour la dilatation du col de l'utérus par le biais
de cylindres qui vont augmenter progressivement le diamètre.
On peut aussi utiliser des laminaires.
|
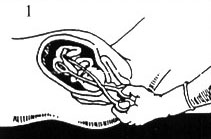 Pendant
l'avortement "proprement dit", l'orientation initiale
du fœtus est identifiée par un appareil à ultra-sons. Pendant
l'avortement "proprement dit", l'orientation initiale
du fœtus est identifiée par un appareil à ultra-sons.
Dès qu'une "extrémité" est repérée,
l'avorteur insère un forceps dans l'utérus par le
vagin et le col et agrippe une des jambes de l'enfant. |
 Après
avoir retourné le bébé dans l'utérus
de manière que ses pieds se présentent en premier
(et donc son visage vers le bas), l'une de ses jambes est tirée
vers l'extérieur. Ensuite, c'est au tour de l'autre jambe,
le torse jusqu'au cou. Après
avoir retourné le bébé dans l'utérus
de manière que ses pieds se présentent en premier
(et donc son visage vers le bas), l'une de ses jambes est tirée
vers l'extérieur. Ensuite, c'est au tour de l'autre jambe,
le torse jusqu'au cou. |
 L'enfant
présente sa mœlle épinière vers le haut
et tout son petit corps se trouve hors de l'utérus sauf sa
tête trop large pour passer le col de l'utérus. L'enfant
présente sa mœlle épinière vers le haut
et tout son petit corps se trouve hors de l'utérus sauf sa
tête trop large pour passer le col de l'utérus.
À ce stade, le bébé est encore en vie mais
plus pour très longtemps puisque l'avorteur passant sa main
le long de la colonne vertébrale de sa petite victime lui
saisi le cou avec deux doigts (le majeur et l'index) pour le dégager. |
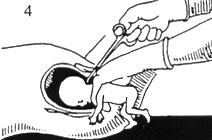 L'avorteur
s'empare alors d'une paire de ciseaux chirurgicaux pointus et, après
avoir localisé la base du crâne de l'enfant l'enfonce
de force. L'avorteur
s'empare alors d'une paire de ciseaux chirurgicaux pointus et, après
avoir localisé la base du crâne de l'enfant l'enfonce
de force. |
 Il
écarte les lames des ciseaux pour élargir le trou
ainsi créé, et après les avoir otés,
insère un cathéter de succion qui aspire la cervelle. Il
écarte les lames des ciseaux pour élargir le trou
ainsi créé, et après les avoir otés,
insère un cathéter de succion qui aspire la cervelle.
Une fois le cerveau affaissé, la tête est devenue assez
petite pour passer le col de l'utérus.
Enfin, le placenta est oté puis les parois utérine
nettoyées. |
|
Illustrations
parues dans TransVie-Mag n° 99 de novembre 1996
|
 |
Stérilet
|
|
Le
stérilet ou dispositif intra-utérin (DIU) dénomination
rendue officielle par la loi Neuwirth de 1967 est un petit objet
en matière plastique avec un manchon en fil de cuivre,
de forme variée et placé dans l'utérus de
la femme.
Le stérilet agit en tuant le petit "œuf"
humain une semaine après sa conception en l'empêchant
de se fixer dans l'utérus (nidation). Cela provoque ainsi
des avortements à répétition.
|
 |
Stérilet
|
|
Le
stérilet ou dispositif intra-utérin (DIU) dénomination
rendue officielle par la loi Neuwirth de 1967 est un petit objet
en matière plastique avec un manchon en fil de cuivre,
de forme variée et placé dans l'utérus de
la femme.
Le stérilet agit en tuant le petit "œuf"
humain une semaine après sa conception en l'empêchant
de se fixer dans l'utérus (nidation). Cela provoque ainsi
des avortements à répétition.
|
 |
R.U.
486 (MIFEGYNE)
|
|
Le
R.U. 486, pilule abortive utilisée vers la 5ème
ou 6ème semaine de grossesse, fut présentée
en 1982 à l'académie des sciences par son inventeur
: le Pr Emile Baulieu.
Il s'agit en fait d'un antiprostérone stéroïdien,
c'est-à-dire qu'il s'oppose à l'effet de la progestérone
(hormone hormone nécessaire à la poursuite de la
grossesse).
Le R.U. 486 est associé, 36 à 48 heures après,
à un autre produit appelé prostaglandine (cenvageme
ouvule ou cytotec per os).
Près de la moitié des avortements sont pratiqués
par le R.U. qui réussit dans 95 % des cas ; en
cas d'échec les avorteurs procèdent à un
avortement chirurgical.
|
 |
Pilule
du lendemain ou Norlevo
|
Dessin
de Chard paru dans
Présent du 16 décembre 1999
|
 Il
s'agit d'une pilule contenant une dose élevée progestatif
après une éventuelle fécondation. Une administration
de NORLEVO équivaut à la dose additionnée du
progestatif de cinquante pilules contraceptives "MINIDRIL"(Lévonorgestrel).
Cette grosse quantité d'hormones pourrait bloquer l'ovulation
ou provoquer un avortement par le même mécanisme que
le stérilet si elle est donnée à l'époque
de l'ovulation. Il
s'agit d'une pilule contenant une dose élevée progestatif
après une éventuelle fécondation. Une administration
de NORLEVO équivaut à la dose additionnée du
progestatif de cinquante pilules contraceptives "MINIDRIL"(Lévonorgestrel).
Cette grosse quantité d'hormones pourrait bloquer l'ovulation
ou provoquer un avortement par le même mécanisme que
le stérilet si elle est donnée à l'époque
de l'ovulation.
Dans les autres cas elle est inefficace, dès lors que le
processus d'implantation a commencé selon le libellé
même des "propriétés pharmaco-dynamiques"
de l'A.M.M. |
|
LES
CONSÉQUENCES D'UN AVORTEMENT
|
 |
Conséquences
physiques de l'avortement chez la femme
|
|
Troubles
ultérieurs de la santé chez la femme
|
 |
Complications
immédiates
|
|
Hémoragies,
perforation de l'utérus ou de l'intestin et septicémie.
|
 |
Risque
de stérilité
|
|
La
moitié des cas de stérilité chez la femme
sont dûs à un avortement provoqué.
La conception peut être devenue impossible par l'infection
des trompes, par adhérences utérines suite à
des cicatrices laissées par le curetage, par une dilatation
excessive du col.
Ce sont surtout les adolescentes et les femmes qui se font avorter
lors de leur première grossesse qui sont le plus touchées.
Pour les femmes utilisant le stérilet, il arrive que survienne
une stérilité définitive.
|
 |
Risque
de grossesse extra-utérine
|
|
Un
avortement augmente les risques de grossesse extra-utérine,
lors d'une grossesse suivante nécessitant alors une intervention
chirurgicale pour sauver la vie de la mère.
D'ailleurs, le nombre de grossesses extra-utérines a doublé,
voire triplé dans les pays industrialisés sur une
période de 20 ans. Il y a là une cause de la
mortalité maternelle du premier trimestre et de stérilité
ultérieure définitive.
Plusieurs études scientifiques ont démontré
que parmi les facteurs à risque on trouvait des antécédents
de chirurgie des trompes ou de l'utérus dûs à
un avortement. Une autre cause de grossesse extra-utérine
est, paradoxalement, le stérilet.
|
 |
Risque
pour les grossesses ultérieures
|
|
La
proportion des fausses-couches et des naissances prématurées
augmente après chaque avortement, en raison des lésions
de l'utérus.
En France, les fausses-couches sont deux ou trois fois plus fréquentes
après deux avortements.
|
 |
Autres
risques
|
|
Par
ailleurs, les gynécologues constatent qu'un nombre croissant
de femmes viennent les consulter pour des irrégularités
mentruelles, pertes accrues, rapports sexuels douloureux suite
à des avortements.
Il arrive souvent que le stérilet provoque une infection
(salpingite généralement) qui se développe
et provoque des saignements et produise des douleurs. Il arrive
aussi que le stérilet perce le fond de l'utérus
et se fiche dans la vessie ou migre près de l'intestin.
Nausées, vomissements, fatigue, douleurs abdominales basses,
vertiges, céphalées, asthénie, tension mammaire,
saignements à type de métrorragies sont les effets
indésirables de l'absortion du Norlevo dite "pilule
du lendemain".
|
 |
Risque
de décès chez la femme
|
|
Ce
risque est loin d'être nul puisque dans une étude
de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) il a été
démontré qu'en France, sur une période de
10 ans (1979-1989), le nombre de décès liés
à l'avortement étaient de 10 à 15 par an
(13 en 1981).
D'ailleurs, selon le Dr Willke, « l'avortement légal,
à n'importe quel stade de la grossesse a deux fois plus
de chances de tuer la femme qu'un accouchement normal ».
|
 |
Les
séquelles psychiques
|
 |
Le
syndrome post-abortif
|
|
L'avortement
cause un préjudice psychologique aux femmes qui l'ont subi.
Aussitôt après un avortement, la femme se croit libérée
d'un fardeau et des pressions subies mais en réalité
il n'en est rien.
Tout d'abord, elle se réfugie dans un état, que
les médecins nomment mécanisme de reniement et de
refus.
Elle refuse d'accepter sa situation dans ses réalités
spécifiques parce qu'elle croit que celles-ci sont trop
douloureuses. Elle renie le fait qu'elle ait autorisé à
tuer son enfant ; elle nie que ce soit une faute et "rationnalise"
le fait que la mort de l'enfant était devenue "nécessaire".
Ce reniement peut durer plus ou moins longtemps mais dépasse
rarement les 10 ans.
La femme pour échapper à la douleur morale et pour
se punir elle-même, décide de s'engager à
fond dans une activité. Pour se débarrasser de sa
culpabilité, de sa honte et de la dépression qu'elle
a peur d'affronter, la femme peut décider de s'engager
dans des "bonnes œuvres"
Parfois, même, il arrive qu'elle sombre dans l'acoolisme
pour oublier, voire prendre des drogues ou rompre avec sa vie
de famille.
Lorsque la femme perçoit vraiment les causes du désordre
psychologique, c'est parce que ce mécanisme de défense
par le refus et le reniement fait place à une prise de
conscience dont les symptômes sont :
– souvenirs répétitifs et intrusifs dans ses
pensées de l'avortement ainsi qu'à l'enfant qui
n'est pas né ;
– au cours du sommeil, rêves réguliers concernant
l'avortement et l'enfant disparu ;
– actes soudains ou sensations comme si l'avortement recommençait ;
– capacité réduite de répondre et de
se situer, voire de s'engager par rapport à l'entourage ;
– sensation de se détacher des autres et de leur devenir
étranger ;
– humeur dépressive ;
– accroissement de l'irritabilité et de l'hostilité
vis-à-vis des autres ;
– insomnie de plus en plus fréquente et longue, perte
de concentration ;
– sentiment de culpabilité d'être encore en
vie alors que l'enfant, lui, n'a pas survécu.
 Pour
en savoir plus, lire la mise au point du Dr Volff, membre du bureau
de Laissez-les-Vivre – SOS Futures Mères, sur
ce sujet. Pour
en savoir plus, lire la mise au point du Dr Volff, membre du bureau
de Laissez-les-Vivre – SOS Futures Mères, sur
ce sujet.
|
 |
DES
TÉMOIGNAGES DE FEMMES SUR LE SYNDROME POST-ABORTIF
|
|
« Mon
mari et moi nous nous connaissons depuis quatorze ans. (...)
J'ai été enceinte dans les premiers jours de
notre relations. (...) Nous avions 20 ans, étions
étudiants et vivions chez nos parents. Tout est allé
très vite. Mise au courant ma mère rendit aussitôt
son verdict : il fallait avorter. Mon ami ne résista
pas à la pression. (...) Et je n'étais pas
assez mûre pour comprendre ce qui se passait malgré
moi. J'ai donc avorté sous anesthésie locale, dans
des conditions psychologiques abominables. Nous avons beaucoup
pleuré et puis le temps est passé... Nous nous sommes
mariés et nous avons eu un enfant qui fait notre joie.
Pourtant notre vie est devenue morne et triste. Nous commencions
à nous éloigner l'un de l'autre. j'étais
devenue obèse et dépressive. Mais nous ne faisions
pas le rapprochement avec l'IVG. Aujourd'hui mon mari est psychologue,
ce qui nous a permis de comprendre. Nous commençons notre
deuil d'avoir perdu l'enfant de l'amour ».
LiLi,
"La Main tendue", Femme Actuelle, avril 1996
|
|
« Pendant
longtemps, j'ai cru que je ne m'en sortirais jamais. J'avais 21 ans
lorsque j'ai dû me faire avorter. Nous étions dans
les années 70. (...) Un matin pluvieux je me suis
donc retrouvée à la gare du Nord avec une quarantaine
de femmes. Un car recouvert de banderoles "Notre ventre nous
appartient", "MLF vaincra", nous emmena en Angleterre.
Pendant tout le trajet, on a chanté à tue-tête,
heureuses, on était des "femmes libérées".
Mais à la clinique (...) c'était sinistre,
les médecins faisaient cela à la chaîne.
(...) J'étais sonnée, j'avais souffert malgré
l'anesthésie locale, je me sentais culpabilisée,
mal dans ma peau. Au retour personne ne disait mot. Chacune gardait
en elle des images de blouses blanches et de spéculum.
Je crois qu'on pleurait toutes. (...) J'ai eu mon premier
enfant à 32 ans, c'est là que j'ai réalisé
que je l'avais attendu pendant toutes ces années.
Claire,
35 ans, Famille Chrétienne, 2 février 1995
|
|
« On
parle beaucoup de la libération de la femme : I.V.G.
(interruption volontaire de grossesse), contraception, tout est
en place pour le mieux-être de la femme ! Mais on passe
sous silence les épreuves que subissent des femmes qui,
pour des raisons personnelles, généralement graves,
paniquent et doivent subir une interruption de grossesse (...).
À la suite d'une très importante série de
soucis matériels et de santé, je viens moi-même
de recourir à un tel acte et maintenant le remords est
là, tenace, qui me poursuit sans cesse. Dans ces hôpitaux,
le personnel, à force de toujours vouloir rester neutre,
devient froid et inhumain. Même un ordinateur montre plus
de "sentiment", ou, du moins, expliquerait les deux
faces du problème.
Qu'est-ce qu'une I.V.G. pour eux ? Une simple intervention,
banale, et ils en font à la chaîne tous les jours !
Je pense qu'il faut rompre cette loi du silence, témoigner,
parler de ce grand vide que l'on ressent, de cette douleur morale,
qui est là.
Avant d'agir, pour permettre à la femme de choisir en
toute liberté, il devrait y avoir quelqu'un qui "plaide"
en faveur de cet enfant.
Pourquoi dans les hôpitaux, ne voit-on pas systématiquement
une assistante sociale qui nous expliquerait simplement, sans
prendre parti, qu'il est possible d'agir autrement, qu'il existe
des droits : aide financière, soutien moral auprès
de tel organisme (...) ?
Voilà comment cela s'est passé pour moi. D'abord
visite chez un gynécologue qui demande ce qui s'est passé :
échec de la contraception ou autre ? Puis une échographie
pour savoir s'il est encore temps. ensuite, visite chez le psychologue.
alors là c'est le bouquet : leçon de morale
mais du style : "vous n'allez pas pondre des gosses comme
ça, surtout avec vos problèmes !" Pourtant
le psychologue aurait un rôle important à jouer.
Après la visite chez l'anesthésiste, le jour J arrive.
Vous avez peur, vous ne voulez pas trop d'un tel acte mais il
ne faut pas traîner, et vous gardez pour vous vos états
d'âme. ensuite, c'est le réveil, tout est fini. Et
puis, vous vous retrouvez chez vous et c'est alors que les problèmes
commencent (...).
J'écris pour que les femmes réfléchissent,
et que l'on sache qu'une I.V.G. n'est pas un acte banal ».
Madame
G., "La main tendue", Femme Actuelle du 10 juillet 1988
|
|
« Mon
I.V.G. a eu lieu sous anesthésie générale,
elle a duré dix minutes, mais je suis restée toute
la journée à l'hôpital à pleurer :
j'avais perdu ma petite fille pour toujours. C'est bizarre, cette
réflexion que j'ai pu faire sur cet embryon de quelques
semaines. C'était une fille, j'en étais sûre,
elle se serait appelée Marine. Je la voyais jouer avec
son grand frère et éclater de rire. En me faisant
avorter, ça venait de s'arrêter (...).
Six mois après, j'ai toujours mal (...). Avorter,
c'est une blessure qui ne guérit jamais ».
Estelle,
42 ans, Famille Chrétienne du 2 février 1995
|

|